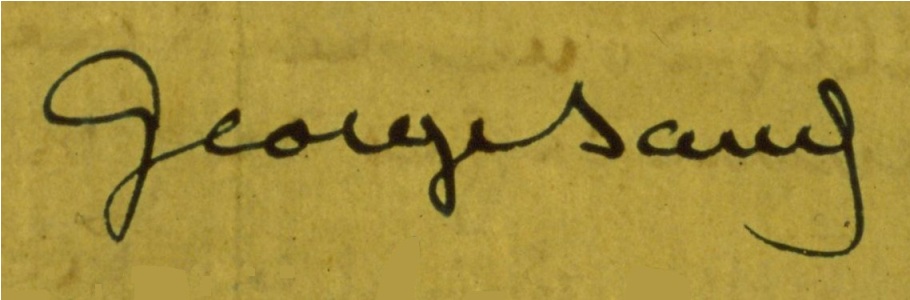JOUR
Pour faire une prairie, prenez un trèfle et une seule abeille – un seul trèfle et une abeille, et la rêverie – La rêverie seule suffira, si on manque d’abeilles.
« Est-ce que ce que j’écris est vivant ? » demandait Emily Dickinson à son éditeur qui ne l’éditait pas. Et ça lui était bien égal. Rien plutôt que toucher un cheveu des anges qu’elle dessinait, mot après mot, sur ses cahiers d’enfant sage.
« J’ai tant besoin de vous depuis que je chancèle » lettre à Sue, sa grande amie, sa belle-sœur, sa voisine, son amour sublimé.
JOUR
La pression continue – verbe au présent actif – adjectif au passif puissant –
La colère monte en moi et je m’y soumets. Ma vie intérieure est encore trop fragile. Elle se trouve à cette étape du chemin où,